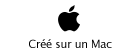Assemblée Plénière 12 juillet 2000
Commentaire d’arrêt : Ass. Plén. 12 juillet 2000
***
Cet arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation, rendu le 12 juillet 2000, s'inscrit dans une évolution jurisprudentielle qui tend à l'élargissement de la liberté d'expression en matière de parodie et à la caricature, face à l'article 1382 du code civil réparant le préjudice extracontractuel.
L'émission « Les Guignols de l'info », diffusée par la société Canal Plus, a prêté à la marionnette de M. X..., président directeur général de la société Automobiles Citroën, des propos mettant en cause les véhicules de la marque Citroën. La société Citroën a assigné en justice Canal Plus au motif que l'émission satirique dévalorisait les produits de la marque automobile, lui causant ainsi un préjudice.
La juridiction de première instance a rejeté cette demande. La société Automobile Citroën a fait appel. La cour d'appel de Paris a de nouveau rejeté la demande le 14 mars 1995 au motif que l'émission « les Guignols de l'info » revêt un caractère de pure fantaisie et est ainsi privée de toute signification réelle et de toute portée. De plus, il n'y a pas d'intention de nuire et ainsi elle n'a pas pu jeter le discrédit sur la société Citroën. La société Automobile Citroën a alors formé un pourvoi en cassation en estimant qu'elle avait subi un préjudice sur le fondement de l'article 1382.
Le 2 avril 1997, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Pour la juridiction suprême, « le caractère outrancier, provocateur et renouvelé des propos tenus s'appliquant à la production de la société Citroën » constitue une faute. De plus, le caractère intentionnel de la faute n'est pas exigé par l'article 1382 du Code civil. Ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382. La cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Reims, qui rend son jugement le 9 février 1999, et déboute une nouvelle fois la société Automobiles Citroën de ses demandes. La société Citroën forme alors un nouveau pourvoi en cassation.
La société Automobiles Citroën considère que les produits de la marque ont été tournés en dérision et que ces propos diffamatoires constituent une atteinte à la personne morale qu’est la société Automobiles Citroën, elle demande donc réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
La cour d’appel de Reims considère que les séquences de l’émission satirique relèvent de la liberté d’expression et qu’elles ne portent pas atteinte à la réputation de la compagnie car sont des fictions.
Ainsi, la parodie d'une marque constitue-t-elle une faute au sens de l'article 1382 du code civil ?
La Cour de Cassation répond par la négative, en affirmant que les propos incriminés relevaient de la liberté d’expression compte tenu du caractère satirique de l’émission. La société Canal Plus n’a donc pas commis de faute. Le pourvoi est donc rejeté.
I- La faute civile couverte par l’humour des propos incriminés.
La distinction faite par la cour de cassation entre réalité et œuvre satirique (B), à pour effet de cacher le fait déviant d’une faute sous le masque de là satire (A).
A- Le fait sous le masque de la satire.
La cour de cassation note que la cour d’appel relève le caractère outrancier provocateur et répété des propos tenus lors de l’émission litigieuse à l’encontre des véhicules produits et commercialisés par la société Automobile Citroën, mais ne caractérise pas la faute de ce fait elle admet qu’elle a violé l’article 1382 du code civil. La caractérisation de la faute devrait pouvoir se traduire par l’influence négative qu’a représentée la diffusion de l’émission sur les ventes de l’entreprise. Si la publicité positive a pour but de faire vendre un produit la publicité négative peut être un frein à la vente et donc constituer une faute si elle est avérée. La cour de cassation a admis que les phrases désobligeantes prêtées à la marionnette de M. X… pouvaient avoir une répercussion sur le téléspectateur et qu’en prétendant le contraire la cour d’appel avait violé l’article 1382 du code civil. Donc la lésion de la société Automobile Citroën est avérée mais la caractérisation de faute n’est pas faite. En reconnaissant l’existence de propos dirigés contre la production même de la société Citroën La cour de cassation a prouvée le caractère fautif de la société audiovisuelle Canal Plus. La cour d’appel statue par des motifs contradictoires qui ont privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du code civil.
Le fait déviant existe mais la cour de cassation opère une différentiation entre réalité et œuvre satirique sur le fondement de la liberté d’expression.
B- La distinction entre la réalité et l’œuvre satirique
La cour de cassation retient que : « les propos mettant en cause les véhicules de la marque s’inscrivaient dans le cadre d’une émission satirique diffusée par une entreprise de communication audiovisuelle et ne pouvaient être dissociés de la caricature faite de M.X…, de sorte que les propos incriminés relevaient de la liberté d’expression sans créer aucun risque de confusion entre la réalité et l’œuvre satirique ». Une satire est une œuvre dont l’objectif est la critique moqueuse de son sujet souvent dans l’intention de provoquer. L’œuvre satirique a pour modèle la réalité. Dans le monde de la satire tous les défauts sont surdimensionnés et pointé du doigt.
L'association dans la moquerie du personnage de M. Calvet et de ses produits des sociétés découle du principe même de l'émission et non d'une volonté de dénigrement.
Compte tenu du secteur d’activité de Canal Plus qui est une entreprise de communication audiovisuelle, aucune concurrence n’existait avec la société Automobiles Citroën qui est une marque de voitures. Ce rappel fait par la Cour de Cassation permet d’empêcher tout « risque de confusion entre la réalité et l’œuvre satirique ». Canal Plus ne peut donc pas être suspecté de dénigré la société Citroën dans le but de nuire à leur activité économique. Ces séquences diffusées à la télévision n’enfreignent donc pas le principe de liberté d’expression
Cependant chaque trait d’humour à sa part de vérité, la distinction entre la réalité et l’œuvre satirique étend les limites de la liberté d’expression, car bien que distinct de la réalité elle n’en reste pas moins un moyen d’influence par une communication plus attrayante. Car si on distingue la satire de la réalité, il n’en demeure pas moins que la critique faite par la satire se rapporte à des faits qui eux sont biens réels, donc l’avis de l’auteur de la satire est répercuté dans son œuvre et transparaît dans ses prises de position. Si l’on dissocie réalité et œuvre satirique, on ne dissocie pas l’influence certaine que l’œuvre satirique a sur la réalité. La conséquence qu’il risque d’y avoir c’est un abus de la liberté d’expression
II- La liberté d’expression comme limite à la faute civile
La liberté d’expression est ainsi consacrée comme limite à la mise en œuvre de la responsabilité civile (A), une liberté qui peut mener à un abus de pouvoir (B).
A- L’atténuation de l’article 1382 au nom de la liberté d’expression
La Jurisprudence consacre un statut privilégié à l’auteur de satire, en effet à l’inverse d’une simple émission télévisuelle, l’œuvre satirique à l’image des « Guignols de l’infos » ne peut avoir de réelle responsabilité juridique de leurs moqueries. La satire a un but distractif, elle amuse le public. L’intension de nuire ne peut pas être caractérisée, malheureusement il y a toujours un parti au dépend duquel la satire se moque. La caractérisation de la faute aurait eu un effet nocif à l’existence même de la satire. Au nom de la liberté d’expression, la cour de cassation a préféré ne pas engendrer de trop grande répercutions à l’humour pratiqué par les auteurs de satire. La question qui ressort alors c’est où doit s’arrêter l’humour ? Car si l’intention de nuire ni la faute ne sont pas caractérisées sous l’image de l’humour, la nuisance peut l’être. Partant de cette décision on remarque un privilège accordé à l’humour et à liberté illimitée on associe souvent abus.
B- Les dangers d’une telle solution
La liberté d’expression est l’une des plus larges libertés que l’on reconnaît en France. Elle figure à l’article 11 des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à l’article 19 de la déclaration universel des droits de l’homme. Une liberté fondamentale qui à une valeur constitutionnelle, sa nature supra légale explique sa dominance face à l’application de l’article 1382 du code civil. La liberté d’expression n’avait pour limite que la diffamation qui est le fait de porter des propos portant atteinte à l’honneur d’une personne physique ou morale et la calomnie qui est l’accusation mensongère portant atteinte à l’honneur de quelqu’un. Cette limite trouve une nouvelle extension dans l’humour. Là où la décision prise par la cour de cassation pourrait avoir une influence négative c’est dans la liberté qu’elle laisse aux fervents pratiquants de l’humour noir aux tendances raciste, xénophobe et autres. De plus l’aspect joyeux et séduisant de l’humour fait souvent perdre le contacte avec la réalité des faits. Donc l’humour a aussi ses limites, à l’avenir de juger de l’utilité de sa codification.